
Quelle justice pour les terroristes ? La question concerne aussi bien les « petites mains » des attentats que les combattants partis sur les terrains de guerre en Syrie ou en Irak depuis 2011. De la rive nord à la rive sud de la Méditerranée, les systèmes judiciaires de trois pays frappés de plein fouet par ces phénomènes sont passés au peigne fin par le réalisateur Christophe Cotteret dans son documentaire Daech, le dilemme de la justice.
Entre Tunis, Paris et Bruxelles, des magistrats, procureurs et familles y confrontent leurs expériences et leurs critiques du système en place. Diffusé le 6 octobre sur la chaîne franco-allemande Arte, ce documentaire est d’ores et déjà en accès libre sur son site internet jusqu’au 3 janvier 2021.
La première partie s’ouvre sur le cas tunisien. On y apprend que depuis 2015, le pôle antiterroriste a traité plus de 4500 affaires et que quelques 1800 personnes sont toujours détenues dans ce cadre.
Pourtant, seule une poignée d’avocats assure la défense des accusés de terrorisme. Alors que le temps politique se mêle souvent d’accélérer le temps judiciaire et que les allégations de tortures policières subsistent, difficile de ne pas reproduire les erreurs du passé.
Jeune Afrique : Vous donnez la parole à certains acteurs sous couvert d’anonymat, dont un juge antiterroriste tunisien. Quelles difficultés avez-vous rencontré dans ces trois pays (Belgique, France, Tunisie) pour recueillir des témoignages sur un sujet aussi sensible que les procès de jihadistes ?
Christophe Cotteret : Les difficultés n’étaient pas les mêmes. La Belgique et la France ont envie de communiquer sur la justice antiterroriste, le parquet met en avant son travail. J’ai en outre pu y obtenir certains accès du fait que la moitié du film était tournée en Tunisie. C’est d’ailleurs ce vis-à-vis qui a convaincu certains de nos interlocuteurs de part et d’autre. Côté tunisien, le procureur Bechir Akremi nous a ainsi donné la première interview de sa carrière du fait que ses homologues français et belges avaient aussi apporté leur témoignage.
Il a également autorisé notre illustrateur, Z, à venir croquer les audiences. Cela constituait une première dans le pays où le dessin de presse n’entre pas dans les tribunaux. La tâche était plus ardue en revanche avec les autorités pénitentiaires ou la police, car au ministère de l’Intérieur, l’accès à l’information est difficile. Il existe encore un écran de fumée en Tunisie. Et la nécessité d’assurer la sécurité entre parfois en confrontation avec la question des droits de l’Homme. C’est d’ailleurs cette tension qui sous-tend le film.
"IL Y A DES COLLABORATIONS JUDICIAIRES ENTRE LA TUNISIE, LA BELGIQUE ET LA FRANCE, QUI ONT SOUFFERT DE LA MÊME MANIÈRE DU TERRORISME"
Pourquoi comparer la situation tunisienne avec celle de la Belgique et de la France ?
Il y a eu des collaborations judiciaires entre ces trois pays, qui ont souffert de la même manière d’un terrorisme très actif. Leurs réponses et difficultés face à ce phénomène se sont fait écho. En Tunisie, on a beaucoup reproché à Ennahdha et à la Troïka d’avoir laissé partir les jeunes sur les zones de combat et d’avoir occulté ces départs, on peut y voir certains points communs avec les cas des voisins européens.

Procès Daesh
Vous soulignez qu’il aura fallu attendre 2014 pour que ces pays cessent de fermer les yeux sur les départs jihadistes en zone de combat. Pourquoi ce tournant ?
À l’époque, le contexte n’était pas le même. Les départs de jeunes pour combattre Bachar al-Assad inquiétaient peu. Personne n’anticipait un possible retour de bâton. D’autant plus qu’en Tunisie, la logique jihadiste depuis les années 1990 n’impliquait pas que les revenants continuent à commettre des actes terroristes.
C’est après l’interdiction, en août 2013, d’Ansar el-Charia que le pays a compris que ce phénomène jihadiste allait se retourner contre lui. Tandis qu’en Belgique, c’est l’attaque du Musée juif par Mehdi Nemmouche en mai 2014 qui a entrainé cette prise de conscience.
La question du retour des combattants est épineuse pour des États qui préfèrent parfois les savoir loin de leur sol. Y a-t-il, là encore, des points communs entre les trois pays étudiés ?
De très nombreux Tunisiens et Tunisiennes se trouvaient dans les zones autonomes kurdes avant les bombardements turcs. La Tunisie ne s’empressait pas plus que la France et la Belgique de demander leur extradition. Les retours y sont gérés individuellement par les avocats sans que l’État ne les réclame.
Selon nos estimations, sur les 4000 à 5000 jihadistes tunisiens partis, 1000 seraient morts au combat et 1000 autres rentrés au pays. 2000 autres pourraient encore être en vie en dehors de la Tunisie. Où sont-ils passés ? Il se peut qu’ils soient pour partie emprisonnés, mais d’autres se sont surement redéployés en Libye.
"À PART QUELQUES ORPHELINS, PARIS ET BRUXELLES N’ONT FAIT REVENIR QU’UN PETIT NOMBRE D’INDIVIDUS. LES AUTRES ONT ÉTÉ LIVRÉS À L’IRAK"
À part quelques orphelins, Paris et Bruxelles n’ont fait revenir qu’un petit nombre d’individus. Les autres ont été livrés à l’Irak — qu’ils aient été, sur le terrain, aide-cuisiniers ou égorgeurs. Or, sur place, les procès ne sont pas équitables et ils peuvent être condamnés à mort du seul fait de leur appartenance à Daesh. Il se pourrait que la France s’en arrange et ait discrètement demandé à l’Irak de ne pas les exécuter.
Vous soulignez qu’en Tunisie le droit à la défense des jihadistes pose plus problème qu’ailleurs. Pourquoi ?
La détention préventive de 14 mois avant tout jugement pose question. Par ailleurs, il y a encore des cas de torture, c’est un secret de polichinelle. Je ne dis pas que la torture est institutionnalisée et systématique, comme c’était le cas sous Ben Ali, mais des méthodes héritées de cette ère subsistent dans certains cas pour obtenir des aveux. Même si elles ont évolué, on a pu recenser des cas de privations de sommeil et autres violences.
C’est d’ailleurs la première question posée aux suspects par le juge en charge du terrorisme : « Avez-vous livré des aveux sous la contrainte de la torture ? » Or, beaucoup de dossiers tombent du fait que les aveux ont été arrachés sous la contrainte durant les premières 48 heures de détention sans présence d’un avocat. Est-ce devenu un procédé de défense lorsque les preuves sont faibles ?
En déclarant qu’en Tunisie « les erreurs d’hier se reproduisent et risquent de créer des bombes à retardement », vous faites référence à l’effet domino de la répression qui alimente la rancœur vis-à-vis de l’État, notamment via des procédures qui touchent l’entourage des suspects…
On ne parvient pas à obtenir de chiffres officiels, mais les procédures S17 s’appliquent à des dizaines de milliers de personnes, jusqu’à 100 000 selon les avocats. Il existe en fait des procédures S1, S17, S19, S20 sans que personne ne sache vraiment à quoi cela correspond, ni quels sont les motifs invoqués. C’est ingérable pour les policiers qui n’ont pas accès à l’ensemble des dossiers mais doivent mobiliser énormément de personnel pour harceler les familles.
Du côté des familles, cela reproduit une logique de haine. Ce sont des pratiques d’un autre âge, contre-productives. Il faudrait a minima que ces fichages transitent par le parquet anti-terroriste et soient sous le contrôle de la justice au lieu de rester entre les mains du ministère de l’Intérieur.
"LA RÉPONSE AU JIHADISME NE PEUT ÊTRE EXCLUSIVEMENT SÉCURITAIRE, ELLE DOIT ÊTRE AUSSI POLITIQUE"
La difficulté à établir des profils types de jihadistes est également largement évoquée dans votre documentaire. En quoi cela complique-t-il le travail de la justice ?
Les études sont légion sur cette question depuis 2005 et force est de constater qu’il n’existe pas de programme de déradicalisation qui fonctionne. Il n’existe pas de profils équivalents, chaque cas doit être traité individuellement. On peut observer tout au plus la rencontre entre un contexte d’adhésion à un combat politique et une radicalisation personnelle. Et il est très difficile de rassembler des preuves.
Ce que dit mon film c’est que dans ces affaires, on ne juge pas toujours un acte mais les intentions et l’univers en arrière-plan. Or, je pense qu’il reste difficile pour les juges de se projeter dans le contexte de l’infraction.
Vous dénoncez « notre diable contemporain » et les facteurs de création voire d’alimentation du phénomène des départs jihadistes au combat. Que voulez-vous dire ?
Je rappelle une évidence pour les acteurs de la lutte antiterroriste qui n’est malheureusement pas partagée par les politiques. C’est la guerre en Irak et notre attitude politique qui ont déclenché ce phénomène. À mon sens, bombarder le califat terroriste affaiblit, certes, ses capacités d’action, mais cela repousse et démultiplie aussi les logiques insurrectionnelles au sein des populations. Cela créé de gros défis à venir, sans pour autant régler le problème du terrorisme. La réponse ne peut être exclusivement sécuritaire, elle doit être aussi politique.
À l’époque, le contexte n’était pas le même. Les départs de jeunes pour combattre Bachar al-Assad inquiétaient peu. Personne n’anticipait un possible retour de bâton. D’autant plus qu’en Tunisie, la logique jihadiste depuis les années 1990 n’impliquait pas que les revenants continuent à commettre des actes terroristes.
C’est après l’interdiction, en août 2013, d’Ansar el-Charia que le pays a compris que ce phénomène jihadiste allait se retourner contre lui. Tandis qu’en Belgique, c’est l’attaque du Musée juif par Mehdi Nemmouche en mai 2014 qui a entrainé cette prise de conscience.
La question du retour des combattants est épineuse pour des États qui préfèrent parfois les savoir loin de leur sol. Y a-t-il, là encore, des points communs entre les trois pays étudiés ?
De très nombreux Tunisiens et Tunisiennes se trouvaient dans les zones autonomes kurdes avant les bombardements turcs. La Tunisie ne s’empressait pas plus que la France et la Belgique de demander leur extradition. Les retours y sont gérés individuellement par les avocats sans que l’État ne les réclame.
Selon nos estimations, sur les 4000 à 5000 jihadistes tunisiens partis, 1000 seraient morts au combat et 1000 autres rentrés au pays. 2000 autres pourraient encore être en vie en dehors de la Tunisie. Où sont-ils passés ? Il se peut qu’ils soient pour partie emprisonnés, mais d’autres se sont surement redéployés en Libye.
"À PART QUELQUES ORPHELINS, PARIS ET BRUXELLES N’ONT FAIT REVENIR QU’UN PETIT NOMBRE D’INDIVIDUS. LES AUTRES ONT ÉTÉ LIVRÉS À L’IRAK"
À part quelques orphelins, Paris et Bruxelles n’ont fait revenir qu’un petit nombre d’individus. Les autres ont été livrés à l’Irak — qu’ils aient été, sur le terrain, aide-cuisiniers ou égorgeurs. Or, sur place, les procès ne sont pas équitables et ils peuvent être condamnés à mort du seul fait de leur appartenance à Daesh. Il se pourrait que la France s’en arrange et ait discrètement demandé à l’Irak de ne pas les exécuter.
Vous soulignez qu’en Tunisie le droit à la défense des jihadistes pose plus problème qu’ailleurs. Pourquoi ?
La détention préventive de 14 mois avant tout jugement pose question. Par ailleurs, il y a encore des cas de torture, c’est un secret de polichinelle. Je ne dis pas que la torture est institutionnalisée et systématique, comme c’était le cas sous Ben Ali, mais des méthodes héritées de cette ère subsistent dans certains cas pour obtenir des aveux. Même si elles ont évolué, on a pu recenser des cas de privations de sommeil et autres violences.
C’est d’ailleurs la première question posée aux suspects par le juge en charge du terrorisme : « Avez-vous livré des aveux sous la contrainte de la torture ? » Or, beaucoup de dossiers tombent du fait que les aveux ont été arrachés sous la contrainte durant les premières 48 heures de détention sans présence d’un avocat. Est-ce devenu un procédé de défense lorsque les preuves sont faibles ?
En déclarant qu’en Tunisie « les erreurs d’hier se reproduisent et risquent de créer des bombes à retardement », vous faites référence à l’effet domino de la répression qui alimente la rancœur vis-à-vis de l’État, notamment via des procédures qui touchent l’entourage des suspects…
On ne parvient pas à obtenir de chiffres officiels, mais les procédures S17 s’appliquent à des dizaines de milliers de personnes, jusqu’à 100 000 selon les avocats. Il existe en fait des procédures S1, S17, S19, S20 sans que personne ne sache vraiment à quoi cela correspond, ni quels sont les motifs invoqués. C’est ingérable pour les policiers qui n’ont pas accès à l’ensemble des dossiers mais doivent mobiliser énormément de personnel pour harceler les familles.
Du côté des familles, cela reproduit une logique de haine. Ce sont des pratiques d’un autre âge, contre-productives. Il faudrait a minima que ces fichages transitent par le parquet anti-terroriste et soient sous le contrôle de la justice au lieu de rester entre les mains du ministère de l’Intérieur.
"LA RÉPONSE AU JIHADISME NE PEUT ÊTRE EXCLUSIVEMENT SÉCURITAIRE, ELLE DOIT ÊTRE AUSSI POLITIQUE"
La difficulté à établir des profils types de jihadistes est également largement évoquée dans votre documentaire. En quoi cela complique-t-il le travail de la justice ?
Les études sont légion sur cette question depuis 2005 et force est de constater qu’il n’existe pas de programme de déradicalisation qui fonctionne. Il n’existe pas de profils équivalents, chaque cas doit être traité individuellement. On peut observer tout au plus la rencontre entre un contexte d’adhésion à un combat politique et une radicalisation personnelle. Et il est très difficile de rassembler des preuves.
Ce que dit mon film c’est que dans ces affaires, on ne juge pas toujours un acte mais les intentions et l’univers en arrière-plan. Or, je pense qu’il reste difficile pour les juges de se projeter dans le contexte de l’infraction.
Vous dénoncez « notre diable contemporain » et les facteurs de création voire d’alimentation du phénomène des départs jihadistes au combat. Que voulez-vous dire ?
Je rappelle une évidence pour les acteurs de la lutte antiterroriste qui n’est malheureusement pas partagée par les politiques. C’est la guerre en Irak et notre attitude politique qui ont déclenché ce phénomène. À mon sens, bombarder le califat terroriste affaiblit, certes, ses capacités d’action, mais cela repousse et démultiplie aussi les logiques insurrectionnelles au sein des populations. Cela créé de gros défis à venir, sans pour autant régler le problème du terrorisme. La réponse ne peut être exclusivement sécuritaire, elle doit être aussi politique.


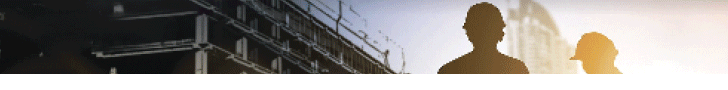





























0 Commentaires
Participer à la Discussion