
Les Pandora Papers jettent une lumière crue sur l’ampleur de l’évasion fiscale au Kenya. En dépit des promesses du chef de l’État kényan de lutter contre la corruption, le pays reste classé 124e sur 180 par Transparency International. Entretien avec la chercheuse Alexia Van Rij, auteure pour l’IFRI (Institut français des relations internationales) d’une étude intitulée « La corruption au Kenya. Décryptage d’un phénomène aux multiples facettes », publiée en septembre dernier.
RFI: Les révélations des Pandora Papers concernant la fortune et l’évasion fiscale de la famille Kenyatta sont-elles une surprise ?
Alexia Van Rij: Non, il n’y a rien d’étonnant. Les fonds détournés au Kenya sont blanchis de quatre manières différentes : l’immobilier, les voitures, les campagnes électorales et l’offshore. Il était ressorti de mes travaux qu’au Kenya, 5 à 10 familles font de l’évasion fiscale. La famille Kenyatta fait évidemment partie de ces familles. En revanche, cela intervient à un moment assez malheureux pour Uhuru Kenyatta parce qu’il souhaite finir son mandat sur une bonne note en laissant un héritage glorieux, à l’image de son père qui avait laissé l’image du père de l’indépendance. Les Pandora Papers confirment également que toute la famille Kenyatta est impliquée, du frère à la maman en passant par les sœurs. Cela illustre bien le phénomène dynastique à l’œuvre au Kenya, et la façon dont pouvoir politique et pouvoir économique sont intimement liés.
Comment s’est bâtie, à l’origine, l’empire économique de la famille Kenyatta ?
Il faut remonter à l’indépendance, lorsque Jomo Kenyatta a pris en quelque sorte le relais des colons britanniques avec son clan, ce que l’on appelle la « Mafia du Mont Kenya ». Ils se sont accaparés les terres les plus riches et les plus intéressantes d’un point de vue agricole. Et c’est cette appropriation des terres arables autour du Mont Kenya dans la région centrale qui a constitué le socle de la fortune des Kenyatta. C’est ce que l’on peut appeler le « péché originel ». Par la suite, on a assisté à des politiques publiques qui ont dirigé les investissements et donc favorisé le développement dans des régions où la famille Kenyatta avait des terres. On a vu également des entreprises détenues par les Kenyatta remporter de gros contrats publics ce qui peut être perçu comme une forme de corruption et constitue une sorte de cercle vertueux, qui permet d’enrichir Kenyatta et son clan.
Vous montrez bien en effet dans votre étude que la corruption au Kenya ne se résume pas à des détournements de fonds et des pots de vin. C’est un phénomène qui s’est, dites-vous, « complexifié » au fil des ans ?
Absolument. Par l’effet du temps, on a une accumulation de la puissance économique et politique de certaines dynasties, qui rend moins perceptible les formes de la corruption. Si l’on s’intéresse par exemple au débat autour du Nairobi Eastern Bypass – une route construite pour mieux desservir certaines régions du pays –, on s’aperçoit qu’elle valorise certains investissements immobiliers de la famille du président Kenyatta. Est-ce du détournement de fonds ou est-ce du conflit d’intérêts ? À mesure qu’elle se complexifie, la corruption devient aussi de plus en plus difficile à qualifier et à identifier. Et ceci ne vaut pas seulement pour la dynastie Kenyatta. La dynastie des Moi, par exemple, est également très impliquée dans cette logique.
Le président Kenyatta s’est pourtant présenté ces dernières années comme le chantre de la lutte anti-corruption dans son pays, y compris de la lutte contre l’évasion fiscale. Ce n’était donc qu’un discours de façade ?
Le chef de l’État a semblé convaincu par la nécessité de lutter d’une certaine manière contre la corruption en raison des avantages que cela peut procurer d’un point de vue relationnel avec les investisseurs publics et privés. Mais il est trop lié de par sa famille et de par son cercle économique et politique à des intérêts qui vont à l’encontre de la lutte contre la corruption. Concernant l’évasion fiscale, des mesures restrictives ont été mises sur pied. La banque centrale a également semblé de plus en plus exigeante à certains niveaux. Donc, d’une certaine manière, on peut dire que oui l’évasion fiscale est devenue plus compliquée pour des personnes moins haut placées que les Kenyatta, les Moi ou les Chandaria. Mais pour les familles très influentes, il y a une forme d’impunité, du fait de leurs relations et du poids important qu’elles ont au Kenya.
Il y a donc une forme de double standard en matière de lutte contre la corruption ?
La lutte anti-corruption est en réalité instrumentalisée à des fins politiques dans le but d’affaiblir les adversaires. Le cercle politique autour de Kenyatta n’a pas intérêt à démanteler le système de la grande corruption puisqu’ils en sont eux-mêmes les bénéficiaires depuis des décennies. La lutte contre la corruption vise donc aujourd’hui essentiellement l’adversaire William Ruto, actuel vice-président, perçu comme un arriviste menaçant pour Kenyatta et pour son cercle. William Ruto a acquis une certaine richesse très rapidement en tant que député, au niveau local, ce qui a fait peur aux dynasties politiques déjà bien implantées puisqu’il pourrait mettre en péril leurs intérêts.
Ce lien intime qui existe au Kenya entre puissance politique et puissance économique est, écrivez-vous, l’un des héritages de la colonisation britannique. De quelle manière ?
Sous la colonisation britannique existait un système d’incitation matérielle que l’on pourrait traduire par la relation patron-client. Ce système visait à convaincre les chefs et administrateurs kényans de collaborer avec les colons britanniques, autrement dit de soutenir leur présence sur le territoire en échange d’incitations pécuniaires ou via des dons de terre. De cette manière, on a pris l’habitude d’assimiler soutien politique et récompense matérielle, pouvoir et richesse. Ces logiques ont été reprises à l’indépendance du Kenya.
Si chaque président qui arrive au pouvoir y voit une possibilité d’enrichissement pour son clan, la corruption au Kenya est donc aussi intimement liée à la question des clivages ethniques.
Cette idée selon laquelle avoir un président de sa communauté garantit une certaine protection et des bénéfices relativement plus importants par rapport aux autres communautés est très présente. Et c’est quelque chose qui est extrêmement cultivé lors des campagnes électorales, nationales ou locales. On joue beaucoup avec ces questions-là. Dans les faits, non, cela ne garantit pas protection et richesse pour toute la communauté ethnique du président ou du gouverneur de comté. C’est une interprétation assez artificielle. Néanmoins c’est une idée répandue sur laquelle jouent les politiques pour se faire élire.
Lors du passage de témoin Jomo Kenyatta et Daniel Arap Moi, on assiste à ce phénomène. Le premier est perçu comme ayant favorisé l’enrichissement de son ethnie. Résultat : à son arrivée au pouvoir le second veut rééquilibrer, et la corruption se perpétue ainsi.
Sous Jomo Kenyatta, on observe en effet une certaine frustration de la part des Kalendjins, mécontents de ne pas bénéficier des fruits du développement et également de la corruption. En réalité, encore une fois, sous Kenyatta, ce ne sont pas tous les Kikuyus qui ont bénéficié du système, mais essentiellement le clan du Mont Kenya autour de lui. Mais par extension, cela a fait naître l’idée selon laquelle cela profitait à toute la communauté économique de Jomo Kenyatta.
Donc, lorsque Daniel Arap Moi arrive au pouvoir, il reprend à son compte cette idée pour perpétuer ce système patron/client dans une posture revancharde qui lui permet en quelque sorte de justifier ses méfaits, largement incarnés par le scandale de détournement de fonds du Goldenberg au début des années 90. Il joue sur l’idée selon laquelle pratiquer la corruption et le favoritisme serait tolérable, parce que son prédécesseur l’a fait aussi et ce n’est qu’une juste revanche. Et c’est ce qui crée une perpétuation du phénomène de la corruption dans le pays.
























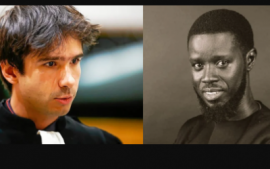








0 Commentaires
Participer à la Discussion