
La chercheuse Olfa Lamloum décrypte les mouvements de contestation qui se succèdent depuis fin 2020, dans un pays où la précarité s’aggrave.
Olfa Lamloum, politologue, dirige le bureau tunisien d’International Alert, une ONG très présente dans les régions de Tataouine (sud, frontière libyenne), de Kasserine (centre ouest, frontière algérienne) et dans les quartiers périphériques de Tunis, Douar Hicher et Cité Ettadhamen. Elle a mené plusieurs études sur le thème de la marginalité dans les quartiers populaires des villes et les régions de l’intérieur de la Tunisie.
Depuis le 14 janvier, date anniversaire de la chute de Zine El-Abidine Ben Ali, des mobilisations sociales ont lieu dans de nombreuses villes de Tunisie. Qui sont ces manifestants ?
Olfa Lamloum Les émeutes de la jeunesse s’inscrivent dans un nouveau cycle protestataire. Déjà, en novembre 2020, les habitants d’El-Kamour, près de Tataouine (sud), ont, via un sit-in, bloqué les activités pétrolières et forcé le gouvernement à prendre des mesures pour les chômeurs, les précaires et obtenir une meilleure redistribution des richesses. Dans leur sillage, plusieurs gouvernorats, durement frappés par la crise économique, ont laissé éclater leur colère. Puis la contestation s’est un peu tassée avant d’être ravivée le 14 janvier. Ce jour-là, qui marquait le dixième anniversaire de la révolution, un berger a été agressé par un policier, à Siliana (centre), l’une des villes les plus marginalisées du pays, parce qu’il avait laissé brouter son troupeau devant le gouvernorat (préfecture). La scène de l’agression a été filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux. Le soir même, des manifestations ont éclaté dans la ville. Cela rappelle évidemment ce qui s’est passé à Sidi Bouzid en décembre 2010 lorsque Mohamed Bouazizi, un jeune vendeur ambulant, s’était immolé par le feu après avoir été humilié par un agent municipal. C’est ce geste qui déclencha la révolution.
La semaine précédant l’incident de Siliana, le 9 janvier, environ 300 supporters du Club africain avaient été arrêtés alors qu’ils manifestaient pour dénoncer la corruption au sein de la direction du club de football. Celui-ci est une association sportive de Tunis, mais il a une assise nationale. Donc, quand il y a eu les manifestations à Siliana, les ultras du club, habitués à affronter la police, ont décidé de se joindre à la contestation.
Notre série pour les 10 ans de la révolution La démocratie tunisienne entre fatigue et résilience
Ensuite, les protestations ont dépassé la ville de Siliana pour atteindre les quartiers populaires des villes et les régions de l’intérieur. La répression a été très importante : 1 600 personnes ont été arrêtées parmi lesquelles un tiers de mineurs. Les 19, 23 et 30 janvier, des collectifs de jeunes et des activistes de la société civile ont à leur tour organisé des manifestations pour dénoncer cette répression.
Cette vague de mobilisations est donc marquée tout à la fois par une plus grande participation de la tranche d’âge des 15-25 ans et une convergence entre les jeunes des quartiers et ceux plus organisés de la capitale.
Pourquoi se mobilisent-ils ?
Dix ans après la révolution, les acquis démocratiques ne se sont pas traduits par davantage de droits économiques et sociaux. Cette nouvelle vague protestataire les remet à l’ordre du jour. Elle dénonce aussi la remise en cause du droit de manifester avec le blocage des avenues et places pour empêcher les rassemblements, mais aussi la militarisation de la police par son matériel et ses méthodes de maintien de l’ordre, ainsi que les provocations de certains syndicats de police.
Les manifestants viennent donc de milieux sociaux et d’horizons politiques divers…
En effet, on observe pour la première fois un début de convergence entre les collectifs de militants expérimentés, des jeunes des quartiers populaires et des groupes d’ultras. En témoigne la manifestation du 23 janvier dans le quartier populaire de Tunis, Cité Ettadhamen, mais aussi la présence, certes faible mais nouvelle, de jeunes des quartiers populaires aux manifestations organisées dans le centre de la capitale, notamment devant le Parlement. C’est un point important, car cela participe au désenclavement politique des quartiers populaires.
Face à cette vague de contestation, comment ont réagi les autorités ?
Elles ont répondu par la répression [un jeune manifestant, Haykel Rachdi, est mort à Sbeïtla, dans le centre ouest]. Du côté des élites et du pouvoir, on a aussi tenté de dépolitiser, de décrédibiliser et même de criminaliser le mouvement en utilisant le terme de vandalisme. Mais les manifestations qui ont eu lieu à Tunis et se sont terminées sans heurts ont permis de discréditer ce discours.
Ces élites sont-elles dans le déni, l’incompréhension ou l’ignorance ?
Les élites au pouvoir savent que la crise économique et sociale est grave et qu’elle s’est encore aggravée avec la pandémie. Les chiffres de l’Institut national des statistiques montrent bien que dix ans après la révolution, la carte de la pauvreté reste la même : ce sont les trois gouvernorats de l’intérieur – Kasserine, Kairouan et Sidi Bouzid – qui sont les plus touchés. Notre organisation travaille sur le terrain à Tataouine (dans le sud, à la frontière libyenne), Kasserine (dans le centre ouest, à la frontière algérienne) et dans les quartiers périphériques de Tunis, Douar Hicher et Cité Ettadhamen. On estime que, dans ces endroits, plus des deux tiers des 18-34 ans n’ont pas de couverture sociale. A Douar Hicher et Cité Ettadhamen, souvent présentés comme de grands pourvoyeurs de « combattants étrangers » partis en Syrie et en Libye, les budgets alloués aux services sociaux sont dérisoires. A Douar Hicher par exemple, qui comptait 82 000 habitants en 2014, la maison des jeunes ne dispose, une fois ses charges payées, que de 470 euros par an pour couvrir les activités de ses animateurs.
Les élites dirigeantes connaissent ces chiffres, mais elles n’ont pas rompu avec les choix stratégiques, économiques, politiques et sociaux du temps de Ben Ali. La gouvernance sécuritaire est le principal mode de régulation et d’encadrement des jeunes des « marges », perçus comme une menace à l’ordre public. Pour s’assurer la paix sociale, on réutilise les vieilles recettes : création d’emplois fictifs dans des sociétés semi-publiques, distribution de quelques aides sociales aux plus démunis, mais aussi tolérance vis-à-vis de l’économie informelle et des activités vivrières.
En tout cas, la contestation semble retomber dans les régions…
La répression a un effet dissuasif très important. Mais les raisons profondes de la mobilisation demeurent. Ce sont les mêmes qui avaient conduit à la vague de contestation contre Ben Ali. Le chômage, la pauvreté, l’abandon scolaire, l’absence de Sécurité sociale… Cette réalité ne change pas. Les mêmes causes entraînent les mêmes effets.
Sur le terrain, que vous disent ces jeunes ?
Dans le cadre de notre dernière étude, « Des jeunes dans les marges », publiée en novembre 2020, nous avons posé cette question : « Comment faire pour améliorer la situation de la jeunesse ? ». A Kasserine par exemple, plus d’un tiers des interrogés a répondu « une nouvelle révolution » et plus de la moitié a déclaré avoir déjà participé à une manifestation. Nous sommes face à une génération qui a connu la révolution et s’est sociabilisée dans cet événement inédit qui a changé son rapport à l’Etat et à la politique.
Dans ces quartiers, les acquis démocratiques sont loin d’être une évidence. Ces jeunes ne votent pas, même s’ils ont été plus nombreux à le faire lors de la présidentielle de 2019. La forme centrale de leur participation politique est la protestation, et la réponse apportée par les autorités est souvent sécuritaire.
Pour ces jeunes, les formes organisées de l’action politique ne sont pas une option?
Il existe un décrochage générationnel important. Les plus jeunes ne croient plus aux partis politiques comme pouvant être des relais pour changer leur vie. Même chose vis-à-vis de la puissante centrale syndicale, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) : c’est la conséquence de l’effritement du salariat parmi les nouvelles générations confrontées aux politiques d’austérité.
Quel rôle jouent les institutions sécuritaire et judiciaire vis-à-vis de cette jeunesse ?
Notre dernier film, Sentir ce qui se passe sorti en janvier 2021, commence par le récit d’Akrout, un jeune de 28 ans de Douar Hicher, qui dit : « Je ne compte plus le nombre de fois où j’ai été arrêté par la police. » Incarcéré quinze jours en 2008 lors d’une manifestation contre les attaques israéliennes à Gaza, il a ensuite été arrêté plusieurs fois au stade ou dans la rue. Une condamnation à dix mois de prison pour consommation de cannabis l’a fait quitter définitivement l’université. Akrout est l’exemple type d’un jeune issu d’un quartier populaire fracassé par la violence institutionnelle.
Le problème avec la police ne se résume pas à des bavures individuelles. C’est celui d’un appareil sécuritaire longtemps au service d’un régime autoritaire adossé à une justice aux ordres. Il n’y a pas eu de réformes de ces institutions, si ce n’est un toilettage superficiel. Aujourd’hui encore, au lieu d’investir dans le social, on renforce la gouvernance sécuritaire.
La réforme des institutions, leur redevabilité, leur contrôle par le bas est une question fondamentale. Or elle est tributaire de la mise en place d’une véritable démocratie participative impliquant les citoyens, en particulier ceux des territoires relégués, et non seulement de « consultations » menées sur injonction des bailleurs de fonds.
























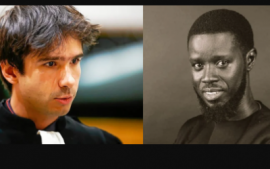








0 Commentaires
Participer à la Discussion