
Le guitariste Latfi Ben Geloune, membre de l’Orchestra Baobab, a estimé que la musique mbalax, telle qu’elle est jouée actuellement au Sénégal, n’est pas exportable dans le reste du monde et a besoin d’être « simplifiée » pour faire comprendre son rythme aux mélomanes.
 "Il faut accepter les choses et les voir en face. On se mord la queue, on tourne en rond. Le mbalax, tel qu’il est joué au Sénégal, n’est pas exportable. Nous n’avons pas besoin d’assises de la musique pour nous rendre compte que ça ne va pas ", a dit le musicien dans un entretien accordé à l’Aps.
"Il faut accepter les choses et les voir en face. On se mord la queue, on tourne en rond. Le mbalax, tel qu’il est joué au Sénégal, n’est pas exportable. Nous n’avons pas besoin d’assises de la musique pour nous rendre compte que ça ne va pas ", a dit le musicien dans un entretien accordé à l’Aps.
Prié de dire si le succès de l’Orchestra Baobab après son retour sur scène en 2001 a un lien avec une possible désaffection du public pour le mbalax, il a rétorqué : « il va de soi que quand on ne sait pas où on va, on revient sur ses pas. Puisqu’on ne parvient pas à s’asseoir et à être d’accord sur une musique donnée, les gens eux-mêmes sont venus à une ancienne musique qu’ils comprenaient mieux ».
Fondé en 1970, l’Orchestra Baobab s’est disloqué à la fin des années 1980, période marquée par l’émergence du mbalax qui s’est imposé au public grâce notamment à la réussite de Youssou Ndour. Le groupe qui doit son nom à la boîte de nuit qui l’accueillait à ses débuts, enregistre, depuis son retour sur scène en 2001, un grand succès marqué notamment par des concerts très suivis à travers le monde et se jouant souvent à guichet fermé.
Latfi Ben Geloune a dit que le Sénégal peut s’inspirer de l’exemple de la Jamaïque, « un petit pays du Tiers-monde qui a pu asseoir une renommée et obtenir des retombées économiques à travers la prépondérance de la musique des rastas à savoir le reggae ». « Si nous voulons que le mbalax parvienne à ce niveau, il nous faudrait revenir vers nous-mêmes et essayer de comprendre ce qui fait que cette musique ne prend pas. C’est déjà un rythme assez complexe pour nous-mêmes Sénégalais », a noté le musicien, par ailleurs président de l’Association des salseros du Sénégal.
Catégorique, il a ajouté « tant qu’on n’aura pas fait ce travail (de simplification), on ne parviendra à rien du tout ». « Ce serait bien si nous pouvions le simplifier et faire en sorte que, quelle que soit l’oreille qui l’écoute, l’on puisse comprendre quels en sont le rythme, le temps fort et le temps faible », a insisté Ben Geloune. Le guitariste suppose que c’est du fait de ce caractère « compliqué » du rythme mbalax, que des mélomanes se sont tournés vers « cette forme de musique (la salsa) qui, même si elle s’apparente un peu à la musique cubaine, est en réalité profondément notre propre musique ».
« Puisqu’il y a une forme qui est le salsa-mballax, dans la mesure où la salsa par beaucoup de côtés ressemble à notre forme de musique à nous, c’est un juste retour des choses. Ce rythme emprunté à nos pays a été exporté avec la Traite négrière. On doit se le réapproprier et, de là, asseoir une musique, des harmonies et des mélodies typiquement sénégalaises », a encore indiqué le musicien.
Il a relevé que la musique est une question d’atmosphère : « vous essayez de capter l’attention de l’auditeur et de le transporter dans un véhicule qu’on appelle la musique et de l’amener dans un pays nommé bonheur ».
Rapportant son analyse au cas de l’Orchestra Baobab, Ben Geloune a dit que les moyens utilisés pour enregistrer ce groupe à ses débuts en 1970 étaient à la limite rudimentaires : magnétophones Nagra, deux pistes en mono, avec deux micros, entre autres.
« Là nous sommes dans le numérique où pratiquement ce sont des tables de mixage de 48 à 52 voire 96 pistes sur lesquelles vous allez enregistrer. Vous avez tellement de possibilités de combinaisons que si vous voulez les utiliser toutes vous risquez de vous fourvoyer et laisser l’essentiel pour aller à l’accessoire », a-t-il estimé.
À Baobab, poursuit Latfi Ben Geloune, « nous nous attachons à l’essentiel. L’essentiel ce sont les feelings que les musiciens ont à jouer ensemble parce que ce qu’il y a de fondamental, et qui existe dans Baobab, c’est qu’il y a un esprit commun qui privilégie la concertation ».
Balla Sidibé ne veut pas voir dans ce retour réussi du Baobab une « revanche » sur le mbalax, accusé à tort ou à raison de l’avoir « chassé » de la scène. « Lorsqu’on quittait le Miami (une boîte de nuit de Dakar), les dakarois l’ont déserté pour venir au Baobab. Les Sénégalais aiment la nouveauté.
Après l’émergence du mbalax, les gens ont adhéré parce que c’était nouveau et ils ne le connaissaient pas. Ils sont partis voir. Ce n’est pas Youssou Ndour qui a fait disparaître le Baobab. Comme le Baobab n’a pas voulu changer son option, ses membres se sont séparés », explique-t-il.
« Les artistes, raconte Balla Sidibé, se sont séparés. J’ai continué avec de jeunes musiciens que j’ai moi-même recrutés. L’acte 1 de l’aventure s’est arrêté en 1990, j’ai alors pris le matériel pour les confier à quelqu’un ».
À son retour, en 2001, le Baobab reprend les choses là où il les avait laissées. Il refait la même musique. « On a l’embarras du choix avec la diversité des langues et des rythmes de ce pays. Les formes son diverses. Ce qu’il y a d’essentiel c’est le fond. Le fond musical du Baobab est invariable. Et c’est une chance de voir que tout le monde est encore là, grâce à Dieu », indique Balla Sidibé.
Aps
























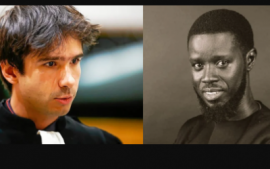








0 Commentaires
Participer à la Discussion